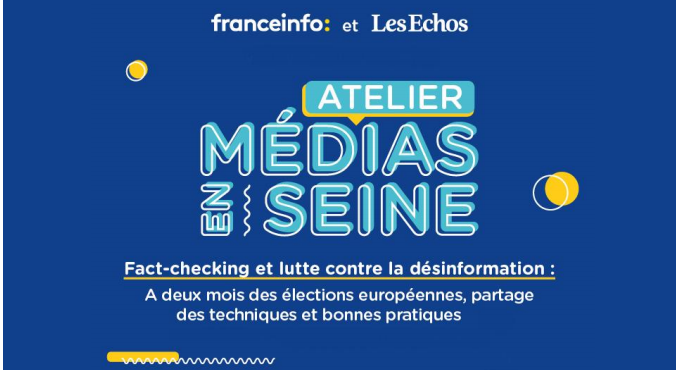Le 18 avril à 8h30. « Où va l’Europe économique, financière et bancaire » avec Olivier Klein, président de la section française de la LECE, DG de la BRED et Philippe Jurgensen, président du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En plein Brexit, prise en tenaille entre la Chine et les Etats-unis, l'Union européenne se prépare à de difficiles élections…